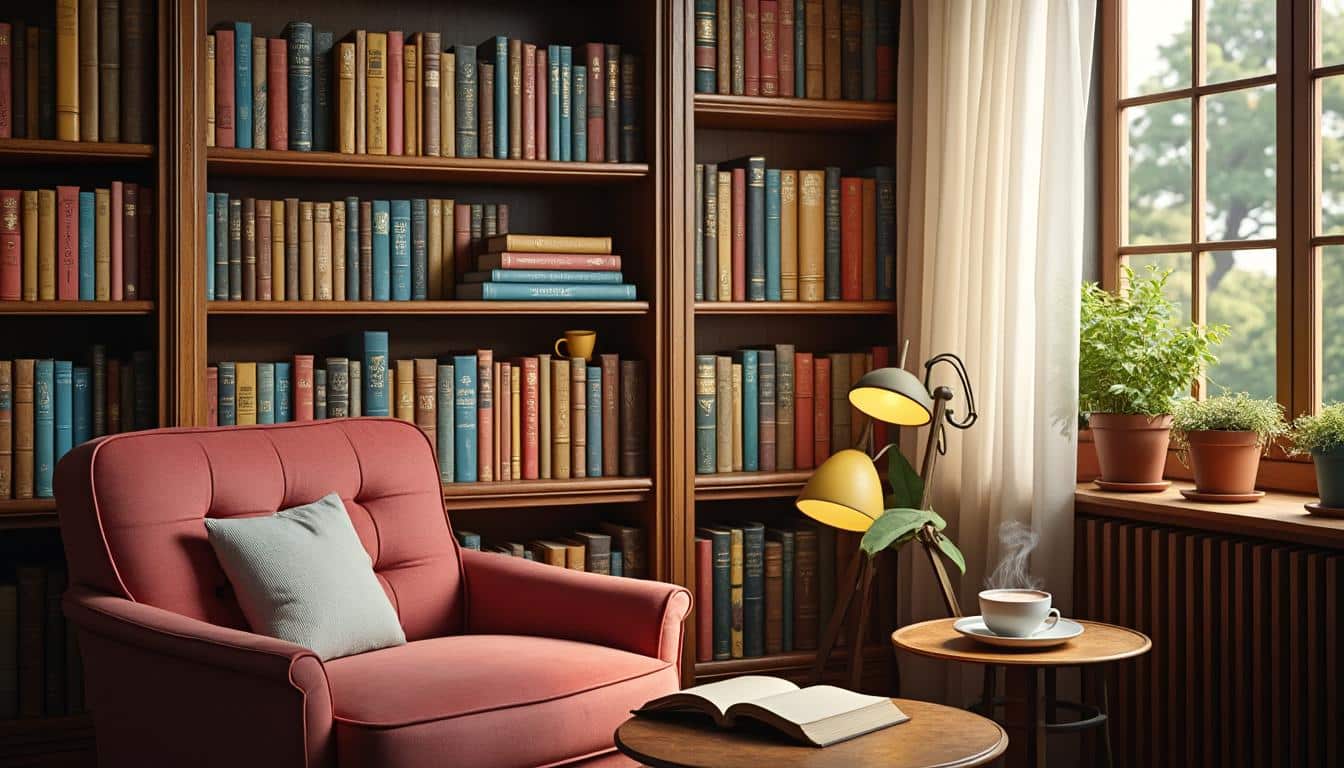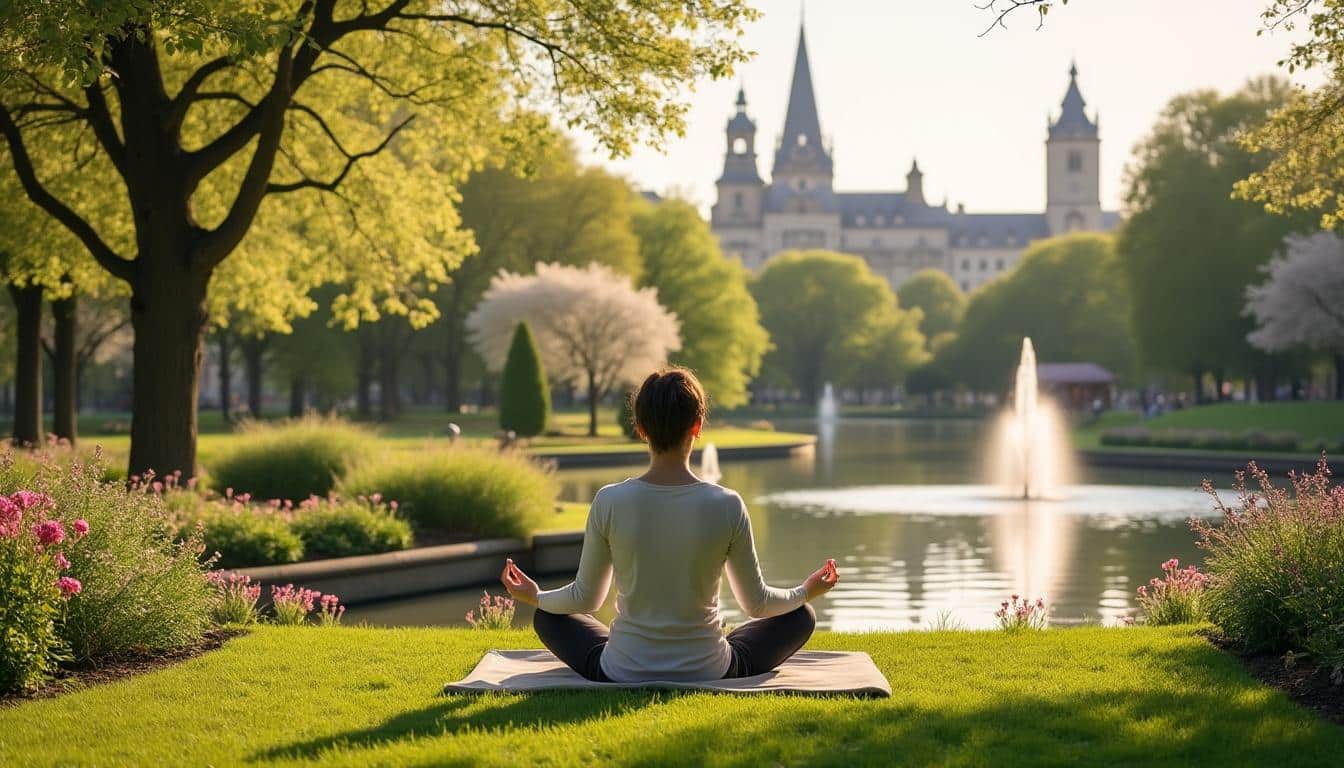Chaque 26 juin, le monde se mobilise pour rappeler une réalité trop souvent occultée : la torture existe encore, partout. La Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, instaurée en 1997, vise à briser le silence, honorer les survivants et soutenir leur réhabilitation. À l’heure où les conflits se multiplient et où les droits humains sont menacés, cette journée revêt une importance croissante.
Cette commémoration est aussi un appel à l’action. Ratifier les conventions, soutenir les ONG, financer la réhabilitation : les défis restent majeurs. Mais la solidarité internationale peut changer le destin de ceux qui ont survécu à l’indicible.
À retenir :
- La journée du 26 juin marque l’entrée en vigueur de la Convention contre la torture et célèbre la dignité des victimes.
- Des campagnes mondiales comme « Voices for Human Dignity » rappellent l’urgence d’agir collectivement.
- Les États et ONG sont appelés à renforcer les mécanismes de justice et de soutien aux survivants.
Une journée née d’une double mémoire historique et juridique
Le 26 juin est plus qu’une date symbolique. Elle croise deux jalons majeurs dans l’histoire des droits humains.
Une date fondatrice pour les Nations Unies
C’est en effet le 26 juin 1945 que la Charte des Nations Unies fut signée à San Francisco, posant les bases du système onusien fondé sur la paix, la sécurité et la dignité humaine.
« L’ONU est née pour protéger l’humanité de ses propres excès. »
Jean-Marc Kervadec, historien des relations internationales
La Convention contre la torture comme pilier du droit international
Adoptée en 1984, la Convention contre la torture est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle définit légalement la torture, oblige les États à la criminaliser, et encourage leur coopération.
Selon l’OHCHR, 173 États ont ratifié la Convention, mais seuls 91 ont adhéré à son Protocole facultatif (OPCAT).
Des défis persistants dans la lutte contre la torture
La torture, qu’elle soit physique ou psychologique, reste pratiquée dans des dizaines de pays. En 2024, le thème « Responsabilité » rappelle que l’impunité demeure un obstacle majeur.
Une définition encore mal comprise
Selon OpenEdition, de nombreux États contournent la définition de la torture en excluant les actes commis par des individus privés, ou en niant les violences psychologiques. Cela entrave les poursuites judiciaires.
L’impunité comme réalité institutionnelle
Dans certains pays, les forces de l’ordre, les services de renseignement ou les groupes armés continuent de pratiquer la torture en toute impunité.
Voici quelques formes de torture fréquemment signalées :
- Electrochocs et asphyxies contrôlées
- Violences sexuelles à des fins de punition
- Privation sensorielle prolongée
- Torture blanche (privation de lumière, isolement)
« Quand l’État devient bourreau, la démocratie recule. »
Noura Belkacem, militante des droits humains
Les réponses internationales : conventions, ONG et mobilisation citoyenne
Le rôle central du Fonds volontaire des Nations Unies
Créé en 1981, le Fonds volontaire pour les victimes de la torture soutient près de 160 projets par an dans 80 pays.
Selon UN Human Rights, ce fonds finance l’accompagnement médical, psychologique, social et juridique des survivants.
« La réparation est un droit, pas une faveur. »
Antonio Rivas, coordinateur de projet pour United Against Torture
Les ONG en première ligne
Des organisations comme l’OMCT, Redress, ou encore IRCT jouent un rôle décisif. Elles :
- Collectent des témoignages
- Forment les avocats et médecins
- Accompagnent les victimes dans les démarches judiciaires
- Organisent des campagnes de sensibilisation
Témoignage :
S., survivant syrien
« Grâce au centre de réhabilitation financé par le Fonds onusien, j’ai pu retrouver une vie digne après des années d’angoisse. »
Tableau des instruments juridiques internationaux contre la torture
| Nom de l’instrument | Date d’adoption | Objectif principal | Nombre d’États parties |
|---|---|---|---|
| Convention contre la torture (CAT) | 1984 | Interdiction absolue de la torture | 173 |
| Protocole facultatif à la CAT (OPCAT) | 2002 | Visites de contrôle dans les lieux de détention | 91 |
| Statut de Rome (Cour pénale internationale) | 1998 | Poursuite des crimes de torture en temps de guerre | 124 |
Initiatives concrètes en 2024 : campagne « Voices for Human Dignity »
Pour le 40ᵉ anniversaire de la Convention, la campagne « Voices for Human Dignity » appelle à renforcer les engagements. Elle met en avant les témoignages de survivants, experts et défenseurs des droits humains.
Les activités prévues incluent :
- Expositions photo sur les survivants
- Webinaires juridiques sur l’impunité
- Ateliers de soutien psychologique
- Mobilisations étudiantes
« Écouter les victimes, c’est déjà commencer à réparer. »
Fatima Aoun, psychologue clinicienne
Tableau des actions recommandées pour soutenir les victimes de la torture
| Action | Impact attendu | Acteurs concernés |
|---|---|---|
| Ratification des textes internationaux | Renforcement des obligations juridiques | États, parlementaires |
| Financement du Fonds volontaire | Accès concret à la réhabilitation | Gouvernements, donateurs privés |
| Plaidoyer citoyen et médiatique | Pression sur les États pour condamner les auteurs | ONG, journalistes, citoyens |
| Formation des professionnels | Détection et documentation efficace des cas de torture | Médecins, avocats, policiers |
Questions fréquentes sur la journée du 26 juin
Pourquoi la journée contre la torture est-elle célébrée le 26 juin ?
Elle marque l’entrée en vigueur de la Convention contre la torture en 1987 et la signature de la Charte de l’ONU en 1945. Le 26 juin est donc une date hautement symbolique.
Comment peut-on aider concrètement les victimes de torture ?
En soutenant les ONG, en participant à des campagnes de sensibilisation, ou en faisant un don au Fonds volontaire des Nations Unies pour les victimes de la torture.
Que prévoit le droit international pour lutter contre la torture ?
Le droit international impose l’interdiction absolue de la torture. La Convention contre la torture et son protocole facultatif en sont les principaux instruments.
Et vous, comment agissez-vous pour soutenir les victimes de torture ? Partagez vos idées, engagements ou témoignages en commentaire !