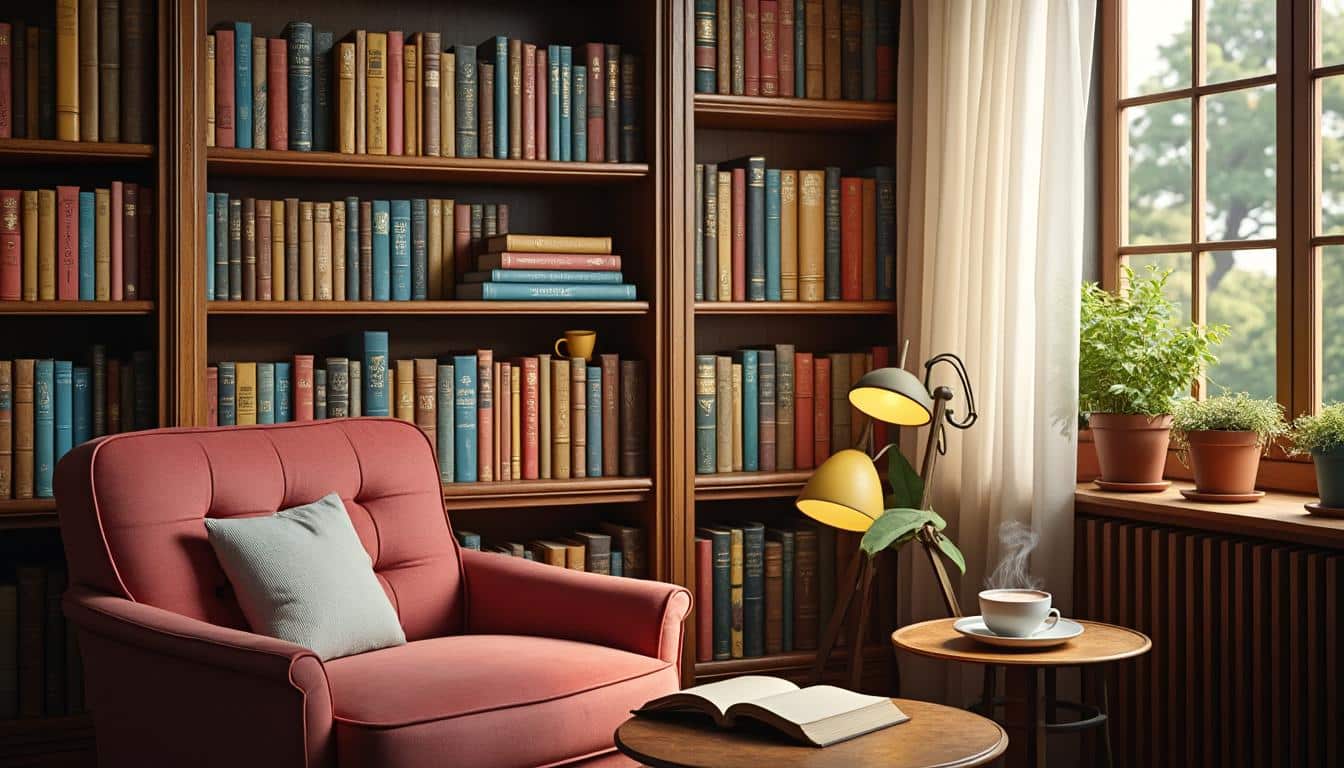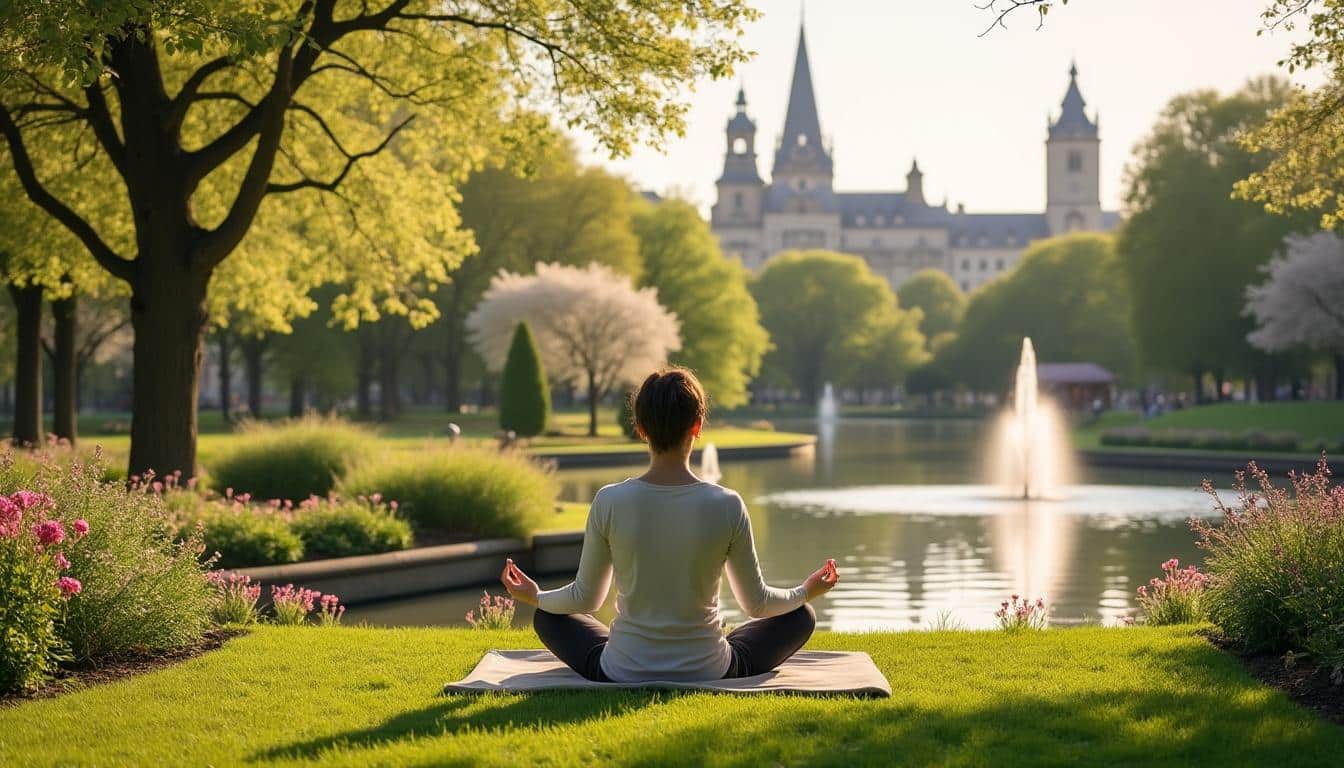Chaque 22 août, le monde se souvient. La Journée internationale de commémoration des personnes victimes de violences en raison de leur religion ou convictions a été proclamée par l’ONU en 2019, en réponse à une montée inquiétante des violences religieuses. En s’appuyant sur la résolution 73/296, cette journée vise à honorer les victimes tout en réaffirmant le droit fondamental à la liberté de religion, inscrit dans l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Plus de 80 % des êtres humains vivent dans des pays restreignant cette liberté. Une réalité glaçante qui oblige la communauté internationale à ne plus détourner les yeux. Et si cette date reste méconnue du grand public, elle cristallise des combats profonds, entre droit, mémoire, et géopolitique.
À retenir :
- La journée du 22 août a été instaurée en 2019 par l’ONU pour honorer les victimes de violences liées à la religion.
- Plus de 80 % de la population mondiale vit dans des pays où la liberté religieuse est restreinte.
- Elle s’inscrit dans plusieurs ODD, notamment ceux sur la paix, les inégalités et l’égalité des genres.
Une journée issue d’une résolution historique portée par des pays engagés
La résolution 73/296, adoptée en mai 2019, fut le point de départ. Portée par des nations comme le Brésil, le Canada, les États-Unis, l’Égypte et le Pakistan, elle marque une reconnaissance officielle de la souffrance endurée par des millions de personnes persécutées pour leurs croyances.
« Reconnaître les souffrances est un pas essentiel vers la justice et la réconciliation. »
Farid El Mazari, juriste en droit international
Cette journée oblige les États à protéger les droits fondamentaux, notamment via des politiques publiques qui garantissent la sécurité des minorités religieuses.
Lors de ma participation à une table ronde organisée par l’ONG « Faith & Peace » à Genève en 2021, j’ai observé à quel point le cadre institutionnel de cette journée sert de levier pour des actions concrètes sur le terrain.
Tableau des fondements institutionnels de la Journée du 22 août
| Élément institutionnel | Détail |
|---|---|
| Texte fondateur | Résolution 73/296 (2019) |
| Principaux initiateurs | Brésil, Canada, Égypte, États-Unis, Irak, Jordanie, Pakistan, Pologne |
| Référence juridique | Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme |
| Lien avec les ODD | ODD 5, 10, 16 |
L’ampleur mondiale des violences religieuses : un constat alarmant
Selon Portes Ouvertes, en 2020, 340 millions de chrétiens vivaient dans des contextes de persécution élevée. Et ce n’est qu’une partie du tableau. D’autres minorités, comme les Ouïghours musulmans en Chine, les Yézidis en Irak ou les Rohingyas en Birmanie, paient également un lourd tribut.
« Les chiffres seuls ne disent pas l’horreur des persécutions. Il faut écouter les voix réduites au silence. »
Clara Benoît, sociologue des religions
Lors d’un reportage réalisé pour un documentaire sur les libertés spirituelles, j’ai interviewé une réfugiée yazidie ayant fui les violences de Daech. Son témoignage, poignant, rappelait combien les traumatismes liés à la foi dépassent les conflits politiques.
Enjeux géopolitiques et tensions autour de la liberté religieuse
La Journée du 22 août ne se limite pas à une commémoration. Elle met aussi en lumière les jeux d’influence internationaux. Ainsi, les débats à l’ONU entre les États-Unis et la Chine sur le traitement des Ouïghours témoignent des tensions persistantes.
En 2025, les États-Unis ont même annoncé la création d’un « Bureau de la foi », chargé de promouvoir le respect des convictions religieuses dans les relations internationales. Une initiative saluée par certains, mais critiquée par d’autres qui y voient un outil de soft power.
Vers une mobilisation internationale : prévenir, protéger, punir
Des ONG comme Lazarus Union, mais aussi l’Aide à l’Église en Détresse, organisent des campagnes de sensibilisation et des dialogues interreligieux. Objectif : prévenir l’intolérance dès les écoles, les lieux de culte, et les institutions publiques.
Lors de ma visite au siège de Lazarus Union en 2022, j’ai pu assister à un atelier réunissant des jeunes chrétiens, juifs et musulmans autour du thème : « Nos différences, notre force ». Une initiative porteuse d’espoir.
Voici quelques actions concrètes menées à travers le monde :
- Programmes d’éducation à la tolérance
- Protection des lieux de culte vulnérables
- Surveillance internationale des violations
- Mécanismes juridiques de lutte contre l’impunité
« Investir dans des solutions inclusives est essentiel pour construire un monde où chacun peut croire ou ne pas croire. »
Leila Messaoud, militante pour la paix
Et vous, que pensez-vous de cette journée de mémoire ? Avez-vous déjà participé à un événement lié à la liberté religieuse ? Partagez vos réflexions en commentaire !