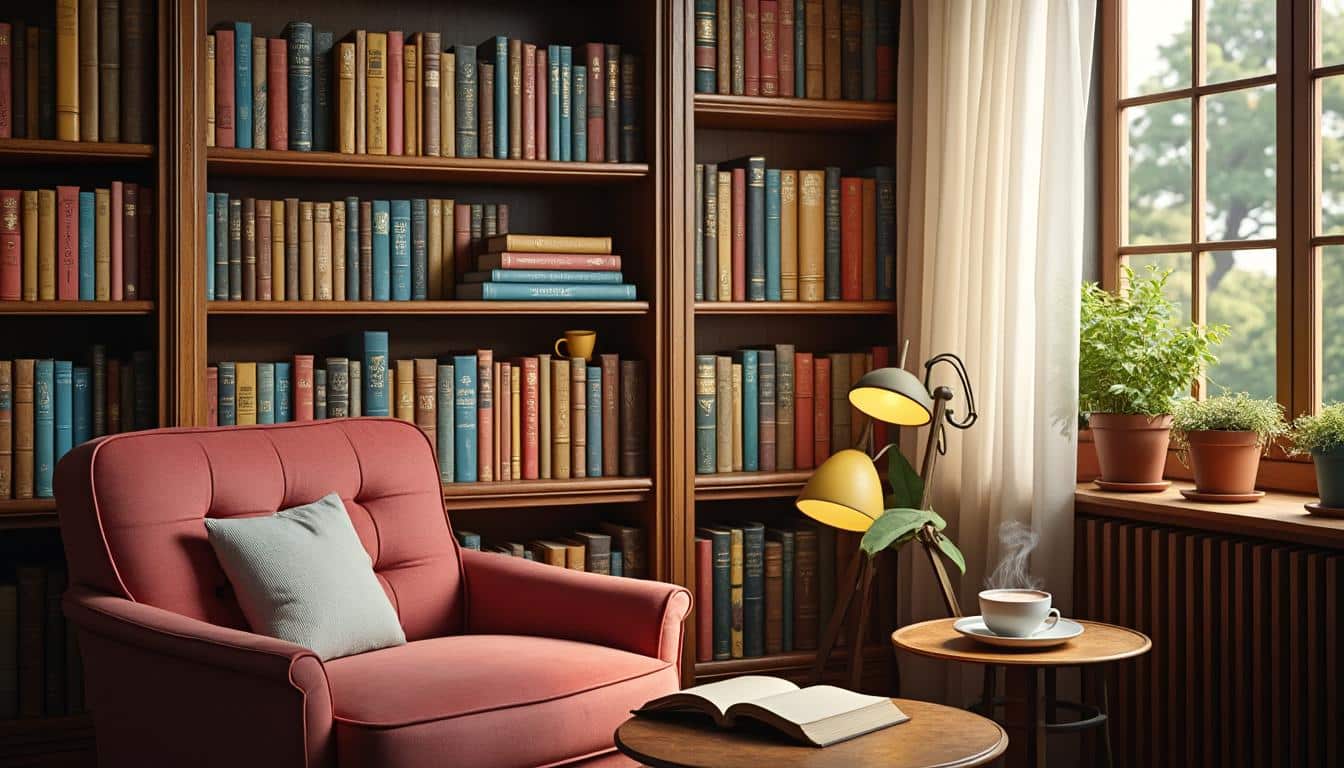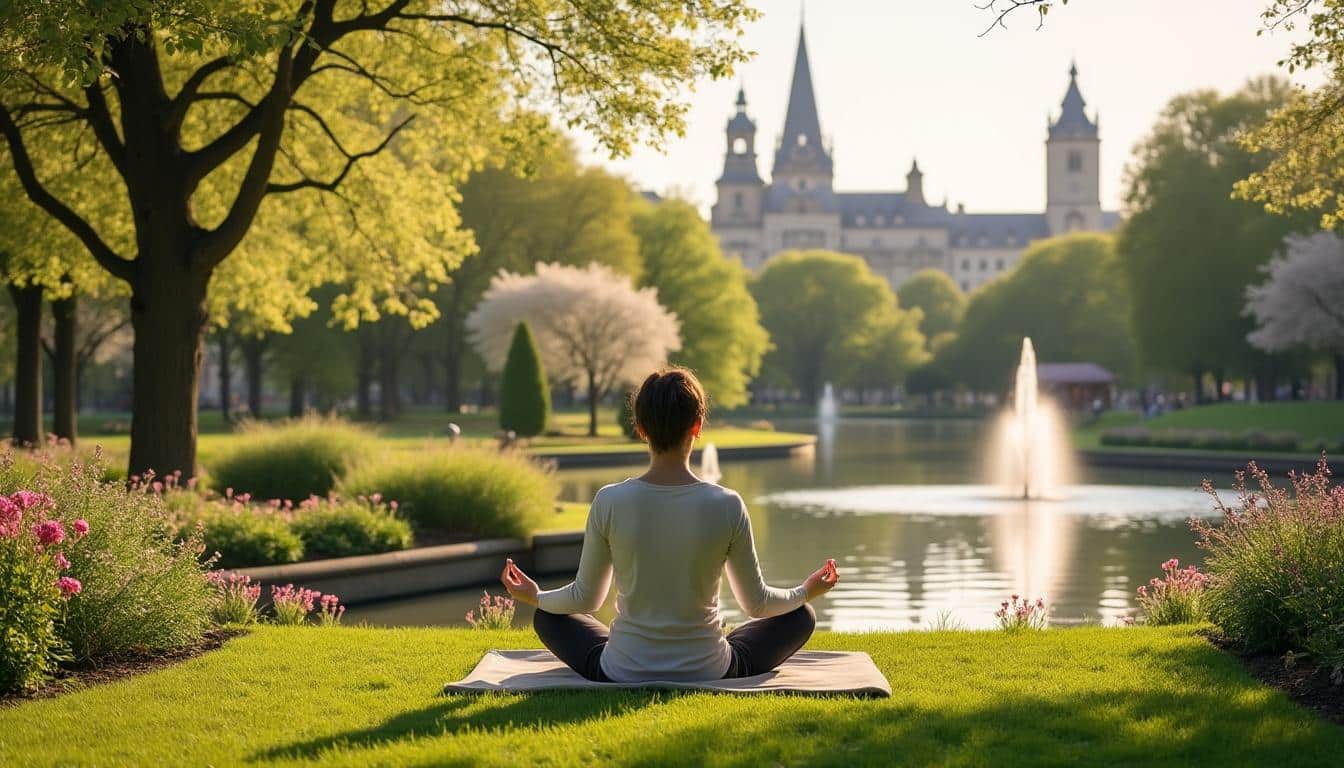La question du « génocide vendéen » ne cesse d’enflammer les débats. Derrière ce terme lourd de sens, se joue un affrontement entre historiens, juristes, militants politiques et gardiens de mémoire. Mais pourquoi cette appellation, pourtant si controversée, continue-t-elle d’être revendiquée ?
À travers une analyse rigoureuse et documentée, explorons les ressorts historiques, les implications juridiques et les enjeux politiques de cette polémique nationale.
À retenir :
- Le débat sur le génocide vendéen oppose historiens, juristes et acteurs politiques.
- Les violences républicaines entre 1793 et 1796 sont incontestables, mais leur qualification divise.
- L’enjeu dépasse l’histoire : il touche à l’identité, la mémoire et à la légitimité républicaine.
Le soulèvement vendéen : une révolte populaire violemment réprimée
Le soulèvement de mars 1793 naît dans un climat de tension extrême. La Convention impose une levée en masse de 300 000 hommes, perçue comme une agression contre les populations rurales. En Vendée, la colère explose. Ce sont les paysans, les artisans, et non d’abord les nobles, qui prennent les armes.
La répression menée par les Républicains se traduit rapidement par des actions d’une extrême violence. Les colonnes infernales de Turreau, envoyées par Paris, multiplient les exécutions sommaires, incendient villages et fermes, anéantissant toute forme de résistance.
« Brûlez tout, n’épargnez ni femmes ni enfants. Détruisez la Vendée ! »
Ordre attribué à Turreau, 1794
Les pertes humaines oscillent entre 100 000 et 200 000 morts, une saignée qui continue de hanter les mémoires régionales.
Tableau des principales actions des colonnes infernales
| Date | Localisation | Nature des actes | Nombre estimé de morts |
|---|---|---|---|
| Janv. 1794 | Les Lucs-sur-Boulogne | Massacre de civils | 500 à 600 |
| Févr. 1794 | Beaupréau | Incendies de villages | 1 200 à 1 500 |
| Mars 1794 | Clisson | Exécutions de masse | 1 000 à 1 300 |
Les arguments en faveur de la qualification de génocide
Le mot génocide n’apparaît dans le droit international qu’en 1948, avec la Convention des Nations Unies. Mais certains historiens, comme Reynald Secher, estiment que les événements vendéens correspondent pleinement à cette définition.
Trois éléments majeurs sont avancés :
- La violence ciblée sur des civils, notamment femmes et enfants.
- Une intention d’extermination, exprimée dans les ordres militaires et dans les pratiques des colonnes infernales.
- Un précédent juridique invoqué dans plusieurs propositions de loi (notamment en 2007), qui assimilent ces actes à des crimes contre l’humanité.
Des archives attestent d’un plan méthodique d’anéantissement. Parmi les documents souvent cités : les rapports de Turreau, qui parlent explicitement de « purger la Vendée ».
Les critiques contre la thèse du génocide : la guerre civile avant tout
Mais la majorité des historiens refuse d’accepter ce terme. Selon Jean-Clément Martin, spécialiste de la Révolution, il faut replacer les faits dans leur contexte :
- Ce n’est pas une extermination ethnique ou religieuse, comme le prévoit la définition stricte du génocide.
- Il s’agit d’un conflit civil armé, où les républicains ont réagi (de façon atroce) à une insurrection organisée.
- Le mot génocide est anachronique, utilisé pour des raisons idéologiques, pas scientifiques.
« Appliquer le mot génocide à la Vendée, c’est instrumentaliser l’histoire pour en faire une arme politique. »
Laurent Avezou, chercheur en histoire moderne
Les violences ont certes été extrêmes, mais elles s’inscrivaient dans une logique de guerre interne où la notion d’ennemi était floue, sans distinction claire entre civil et combattant.
Mémoire, instrumentalisation et batailles politiques
Depuis les années 1980, le mot génocide vendéen est brandi comme outil politique. En 2007, l’UMP et le Front National ont soutenu des propositions de loi pour reconnaître ces événements comme tels.
Il s’agit d’une stratégie de réhabilitation identitaire : rétablir la mémoire d’une région longtemps négligée, voire stigmatisée pour son opposition à la Révolution.
Ce récit vient contester une lecture idéalisée de la République. Il sert aussi d’argument pour remettre en cause certains fondements idéologiques de la France moderne.
Ces initiatives sont aussi nourries par :
- Un ressenti de marginalisation des mémoires régionales dans le récit national.
- Une volonté de rééquilibrer la mémoire collective, souvent centrée sur Paris et les figures révolutionnaires.
- L’essor d’un régionalisme politique qui valorise les particularismes historiques.
Et vous, pensez-vous que les crimes commis en Vendée relèvent d’un génocide ou d’une guerre civile sanglante ? Partagez vos avis en commentaire, la discussion est ouverte.